Un trousseau de mariée était jadis une bonne réserve de linge (torchons, draps, serviettes, chemises, etc…). Pendu pour ne pas moisir, le gros du linge sale pouvait donc attendre au grenier la grande lessive de plusieurs jours opérée une ou deux fois par an. Une lavandière rétribuée était parfois appelée.
Celles qui n'avaient pas accès aux puits, aux lavoirs et aux fontaines lessivaient sur une pierre ou une planche inclinée au bord d'une source, d'un cours d'eau ou d'un étang. Un long trajet de retour avec le linge mouillé pesant suivait souvent ce labeur ingrat opéré dans une position inconfortable…
La région comptait quelques bassins bas privés à la fin de XVllème siècle, surtout dans les grandes villes. Ils exigeaient de s'installer à genoux :
- le lavoir d'Aix-en-Provence (1707) fut destiné à bannir le lavage des fontaines du Cours Mirabeau actuel.
- la fourniture d'eau fut toujours déficiente à Marseille. Ses lavoirs étaient sales, délabrés, l'air y était putride, le racket actif. Ils devinrent publics à la Révolution sans abolir pour autant les extorsions. Un canal relia en 1848 la ville à la Durance1. Il améliora la vie citadines tout en assurant l'essor agricole et industriel local.
 LA LOI IMPÉRIALE DE 1851
LA LOI IMPÉRIALE DE 1851
Soucieux d'hygiène publique, Napoléon lll favorisa l'édification de lavoirs. Un prêt du « Pari mutuel2 » couvrait jusqu'à 75% du prix des travaux si le maire respectait certains points :
- rapprocher le site des usagères.
- fixer une hauteur des bacs autorisant le lavage debout.
- isoler le lieu du soleil et des intempéries par un toit.
- placer des égouttoirs pour alléger la charge au retour.
- scinder le bassin, l'eau devant couler du plus propre vers le plus sale pour limiter les épidémies, surtout le choléra3 :
fontaine --> bac de rinçage --> bac de lavage.
Le lavoir s'avérant un bâtiment public incontournable, les constructions prospérèrent et la lessive fut peu à peu bannie des fontaines. Les chantiers fléchirent à partir de 1914, les villages de Provence s'étant bien équipés.
L'eau courante au domicile, les lessiveuses en zinc et surtout les machines à laver firent lentement oublier ces édifices. Gratuits, ils n'assuraient plus très souvent que les rinçages grands consommateurs d'eau.
Beaucoup de lavoirs furent alors détruits pour créer quelques places de parking… Cette tendance semble s'être arrêtée. Beaucoup des municipalités actuelles restaurent et parfois fleurissent les édifices sauvés dans le cadre de la mise en valeur de leur patrimoine communal.
L'ARCHITECTURE
En général, des piliers de pierres ou de fonte portaient un toit à une ou deux pentes en tuiles ou en lauzes4. Le bord biseauté du bassin ramenait l'eau vers l'intérieur, épargnant les laveuses. Un mortier étanche5 en jointurait les pierres de grand gabarit. Le trop plein suivait la pente douce du sol carrelé, caladé6 ou dallé. Une conduite en terre cuite ou en plomb l'évacuait à l'extérieur : fossé, pesquier7, abreuvoir, ruisseau, champ, égout pour les plus récents. Une purge permettait de vider les bacs afin de les curer.
Les budgets communaux plutôt serrés firent primer la simplicité et la solidité sur le style (ci-dessous à gauche). Deux lavoirs régionaux ont été classés « monument historique » : Lambesc de 1759 dans les Bouches-du-Rhône (au centre) et Mollans-sur-Ouvèze du XlXème siècle dans la Drôme (à droite).
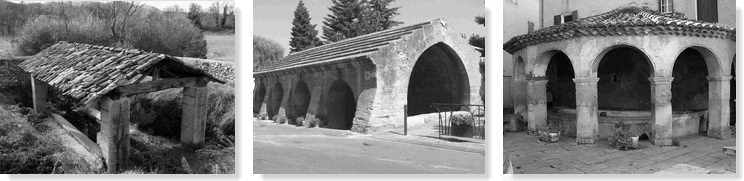
AU LAVOIR
Les hommes se voyaient à la chasse, au café ou au travail. Les femmes, cantonnées dans la garde des enfants et les tâches ménagères, sortaient peu sauf pour fréquenter l'église. Le lavoir était pour elles un lieu convivial que les maris évitaient, mais où certains les suspectaient de boire…
D'abord trempé dans l'eau, le linge était ensuite frotté au « savon de Marseille » longtemps réputé être le meilleur détergent du monde. Puis il était frappé rudement au battoir pour en évacuer la crasse et le savon. Ce processus était répété. Le rinçage exigeait de tordre et retordre le linge avant son égouttage.
L'école hygiéniste prôna de terminer les lessives par un séchage au soleil sensé tuer les derniers miasmes.
L'eau chaude arriva vers 1875. Un mutilé ou un vieillard, pour bannir une aventure8 dans ce lieu exclusivement féminin, assurait sa vente et alimentait le feu (ci-dessous). La cendre récupérée9 servait à blanchir le linge.

CERTAINS LIEUX RÉSERVÉS
Quelques lavoirs isolés furent affectés aux linges souillés des malades contagieux, celui présent dans la localité profitant aux seuls habitants « sains ». Par exemple :

- Saint-Michel-l'Observatoire : le lavoir hors du village réservé au linge des malades se nomme « La Marceline » (ci-dessus à gauche). Celui à usage normal est situé dans la localité (à droite).
- Saint-Chamas : le lavoir « Du Polygone » doit son nom au terrain militaire voisin où s'effectuaient des essais de tirs. Il fut bâti sur la rive nord de l'étang de Berre vers le XVlllème siècle à destination du linge contaminé (ci-dessous). De l'eau de source l'alimente. Des tapis y sont toujours lavés…

1 82 km partant près de Pertuis, il fut l'unique alimentation de Marseille. Il ne fournit plus que les 2/3 de son eau depuis 1970.
2 ancêtre du P.M.U. 3 « Le hussard sur le toit », de Jean Giono.4 pierre plate utilisée en couverture de toit.
5 chaux hydraulique ou ciment romain. 6 pavé de pierres plates disposées en chant.7 réserve d'eau à usage agricole.
8 « Glisser sur le chemin du lavoir » signifia être infidèle à son époux.9 l'eau chaude libère ses sels de potasse.

