La confiserie, la pâtisserie, la menuiserie, la pharmacie, la papeterie et l'industrie utilisent leur bois, leurs bourgeons, leurs pignons ou leur résine.
LE PIN MARITIME
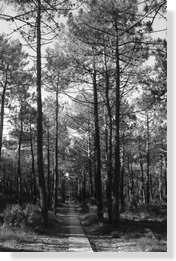 Aussi nommé « pin des Landes », cet arbre à croissance rapide couvre plus de 10 % des surfaces boisées du pays. Il sert à fixer le sable, les dunes en particulier.
Aussi nommé « pin des Landes », cet arbre à croissance rapide couvre plus de 10 % des surfaces boisées du pays. Il sert à fixer le sable, les dunes en particulier.
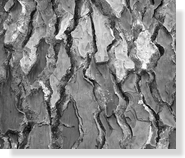 Son écorce, d'abord gris pâle, se crevasse et vire peu à peu au rougeâtre. Ses aiguilles, rigides, longues de 9 à 20 cm, de section semi-circulaire, réunies par deux, vert foncé brillant, passent au fauve avant de tomber. Les fourmis en font alors leur litière.
Son écorce, d'abord gris pâle, se crevasse et vire peu à peu au rougeâtre. Ses aiguilles, rigides, longues de 9 à 20 cm, de section semi-circulaire, réunies par deux, vert foncé brillant, passent au fauve avant de tomber. Les fourmis en font alors leur litière.
Le pin maritime craint le froid, aime le soleil, les sols non calcaires et les zones sableuses. Il est banal de le voir dans les forêts longeant la côte méditerranéenne. Il peut atteindre 30 m, et vivre 200 ans.
On tirait jadis de sa résine la térébenthine, le calfat pour étanchéïfier les coques de navires1, la poix et une essence similaire à de l'encens. Son bois étayait les galeries des mines de charbon avant l'arrivée de poutres en acier au XlXème siècle.
Les charpentiers, les menuisiers et les papetiers l'utilisent toujours.
LE PIN SYLVESTRE
Aussi appelé « pin rouge », il prospère vers 700 m d'altitude où il recherche la lumière. C'est un arbre pionnier, c'est-à-dire capable de pousser dans des zones dénuées de toute végétation.
 La zone basse de son tronc est totalement dégagée car les branches y sèchent naturellement, puis cassent. Son écorce, ocre-rouge, pèle en plaques fines irrégulières. Ses aiguilles, souples, vrillées, vert-bleu aux reflets argentés, groupées par deux, mesurent entre 4 et 7 cm. Elles se décomposent mal au sol entravant ainsi la naissance d'un sous-bois. Les cônes apparaissent en septembre, mâles à la base des rameaux, femelles à leur extrémité. La hauteur du pin sylvestre peut excéder 40 m. Il vit environ 500 ans.
La zone basse de son tronc est totalement dégagée car les branches y sèchent naturellement, puis cassent. Son écorce, ocre-rouge, pèle en plaques fines irrégulières. Ses aiguilles, souples, vrillées, vert-bleu aux reflets argentés, groupées par deux, mesurent entre 4 et 7 cm. Elles se décomposent mal au sol entravant ainsi la naissance d'un sous-bois. Les cônes apparaissent en septembre, mâles à la base des rameaux, femelles à leur extrémité. La hauteur du pin sylvestre peut excéder 40 m. Il vit environ 500 ans.
Ses aiguilles servirent à faire une ouate que l'on parvenait à filer afin de produire une étoffe ressemblant à de la flanelle. Les charpentiers de marine appréciaient la qualité de son bois.
Le pin sylvestre est à présent utilisé dans la menuiserie, l’industrie du papier et la construction.
LE PIN NOIR D'AUTRICHE

Jeune, il est garni de branches très bas. Ses aiguilles, réunies par deux, vert foncé, raides, piquantes, mesurent de 8 à 20 cm de long. Ses cônes sont matures après 3 ans : les cônes mâles sont de couleur jaune, les cônes femelles enduits de matière cireuse sont rouge foncé. La hauteur du pin noir d'Autriche croit de 40 à 70 cm chaque année pour atteindre entre 20 et 55 m à l'âge adulte qu'il atteint après de 15 à 40 ans.
Son port en forme de cône arrondi prend une allure assez erratique en vieillissant et son écorce gris-brun à larges écailles se fissure. Il peut vivre 500 ans.
Le pin de Salzmann est une sous-espèce du pin noir d'Autriche douée d'une grande résistance à la sécheresse. Il devrait être de plus en plus valorisé pour tenir compte du réchauffement climatique de la planète.
LE PIN PARASOL
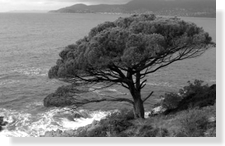 Naturellement disséminé, c'est un arbre des maquis et des bois du Sud-Est. D'abord sphérique, sa forme suggère un parasol déployé dès l'âge adulte. Sa quête constante de soleil explique son manque de verticalité fréquent et son tronc souvent divisé à la base. Il est sensible aux froids durables.
Naturellement disséminé, c'est un arbre des maquis et des bois du Sud-Est. D'abord sphérique, sa forme suggère un parasol déployé dès l'âge adulte. Sa quête constante de soleil explique son manque de verticalité fréquent et son tronc souvent divisé à la base. Il est sensible aux froids durables.
 Ses aiguilles glauques2, réunies par deux, piquent peu. Ses cônes sont aussi longs que larges. Ils mesurent 10 cm à maturité. La hauteur du pin parasol excède rarement 30 m. L'arbre peut vivre 250 ans.
Ses aiguilles glauques2, réunies par deux, piquent peu. Ses cônes sont aussi longs que larges. Ils mesurent 10 cm à maturité. La hauteur du pin parasol excède rarement 30 m. L'arbre peut vivre 250 ans.
Il est aussi appellé « pin pignon » car ses graines se cuisinent : plat en sauce de type tajine alliant sucré et salé, pâtisserie, garniture de salades, etc… Les thés à la menthe tunisiens et syriens intègrent parfois ses pignons jugés localement aphrodisiaques…
 LE PIN D'ALEP
LE PIN D'ALEP
Aussi appelé « pin blanc » ou « pin de Jérusalem », cet arbre s'accommode des embruns méditerranéen. Il pousse jusqu'à 800 m d'altitude sur les flancs sud des zones de garrigue. C'est le seul grand arbre acceptant facilement de vivre dans la roche calcaire au sol rare, pauvre et sec. Un fort dépôt de neige peut briser ses branches et même le déraciner. Il craint de plus le gel prolongé.
 Ses aiguilles, souples, fines, groupées par deux, font 10 cm de long. Jeune, il a un port régulier et une écorce lisse de couleur grise qui se fissure lentement avec l'âge, brunit, tandis que le tronc devient tortueux. Dégarnis à la base, les plus vieux arbres ont un houppier3 dispersé et une cime irrégulière peu dense. Le pin d'Alep peut atteindre 20 m de haut. Il côtoie souvent le chêne vert.
Ses aiguilles, souples, fines, groupées par deux, font 10 cm de long. Jeune, il a un port régulier et une écorce lisse de couleur grise qui se fissure lentement avec l'âge, brunit, tandis que le tronc devient tortueux. Dégarnis à la base, les plus vieux arbres ont un houppier3 dispersé et une cime irrégulière peu dense. Le pin d'Alep peut atteindre 20 m de haut. Il côtoie souvent le chêne vert.
La médiocre qualité de son bois le destine souvent à finir comme caisse d'emballage…
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN
Les pins maritimes, les pins sylvestre et les pins d'Alep forment à eux seuls environ 20% de la forêt française.
Les chenilles processionnaires du pin, défoliantes, urticantes, dangereuses pour l'homme et pour les animaux, anémient durablement et même détruisent beaucoup de pins en dévorant leurs aiguilles. Leurs cibles favorites sont les pins noirs d'Autriche…
Elles sont sensibles au froid. Le réchauffement climatique de la planète actuel joint à l'utilisation de plus en plus fréquente de conifères dans les aires de boisement fait progresser inexorablement leurs colonnes chaque année de plusieurs kilomètres vers le nord de la France ainsi qu'en altitude…

1 calfatage. 2 d'un vert blanchâtre ou bleuâtre comme l'eau de mer.3 ensemble des branches, rameaux et feuillage.

