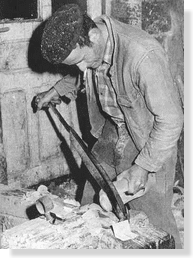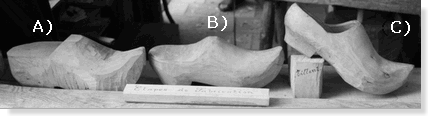
Chaque sabot se taillait dans un seul morceau de bois. A chaque étape correspondait un outillage :
A) le « bûchage » à l'herminette3, plutôt confié à l'apprenti, ébauchait la forme d'un pied gauche ou droit.
B) le « planage » au racloir, au paroir4 (en haut à droite) et au dégageoir5 affinait l'aspect extérieur.
C) le « creusage » à la gouge, à la vrille et à la cuillère tranchante évidait un logement pour le pied.
Le bois étant travaillé vert, un long séchage suivait au soleil ou sur des claies suspendues au dessus d'un feu alimenté par les copeaux récupérés sur le sol. La rétraction résultante pouvait fendiller ou même fêler le bois, condamnant le sabot…
Une finition plus ou moins élaborée concluait : marque de l'artisan, vernis, teinture, peinture, gravure, sculpture. Des pointures variées permettaient de chausser toute la famille. Commander du « sur mesure » ou acheter deux sabots dépareillés pour les infirmes ne posait pas de problème.
 LES SABOTIERS
LES SABOTIERS
Certains d'entre eux, très rares, furent des « Compagnons du tour de France6 » ou plus récemment ont été élus « Meilleur ouvrier de France7 ». Mais la plupart firent à leur époque un métier de pauvre pour les pauvres. Occupant des abris sommaires dans les forêts, ils taillaient chaque jour jusqu'à dix paires de sabots. La formation de l'apprenti et le travail étaient plutôt familiaux.
Il y eut quelques tentatives de mécanisation au début du XXème siècle : le palpeur d'une machine balayait un modèle tout en recopiant cette forme sur une pièce de bois brut. Elles restèrent marginales car trop restait à finir à la main.
Les sabotiers fréquentaient les foires et les marchés. Certain ouvrirent un petit atelier de village. Mais le déclin du monde rural les condamnait à terme malgré un regain d'activité lié à la rareté du cuir sous l'Occupation. La commercialisation des bottes en caoutchouc ruina définitivement ces artisans…
Le tourisme fait toujours vivre des petites productions de sabots décoratifs.
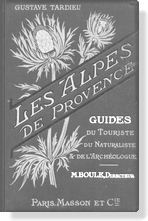 DANS LA MONTAGNE DE LURE
DANS LA MONTAGNE DE LURE
Gustave Tardieu (1851-1932), pharmacien à Sisteron, érudit, descendait d'une lignée de marchands-droguistes de Saint-Etienne-les-Orgues. Fruits d'années d'observations sur le terrain, il écrivit en 1912 « Les Alpes de Provence : guides du touriste, du naturaliste et de l'archéologue » encore pertinent pour l'essentiel, et divers fascicules. L'un d'entre eux signale, sans en donner la position, des tas de galoches et de sabots à l'abandon croisés lors d'une marche à l'ubac de la montagne de Lure en 1887.
Conséquence d'une forte déforestation du massif, ce flanc abrupt avait peu à voir avec l'actuel couvert boisé. Les glissements de terrain et les éboulements y étaient courants. Seul son accès difficile sauva sa fayée8 sommitale. Il est possible que ce soit là que le bois de hêtre était taillé, assez fin pour obtenir des sabots plus légers. Gustave Tardieu semble avoir manqué de peu le dernier sabotier du massif de Lure…
LES ESSENCES
Le bois utilisé variait selon la région et l'usage désiré :
- léger, solide, peu froid l'hiver, frais l'été, bon marché : le bouleau.
- tendre, léger, mais sujet à l'usure : le peuplier.
- solide mais lourd, en zone montagneuse : le hêtre.
- peu glissant, adapté aux activités portuaires : l'orme.
- mou, les gravillons incrustés sécurisant le trajet sur la glace : le saule.
- adaptés à la sculpture élaborée des sabots de luxe : le noyer et beaucoup d'arbres fruitiers.
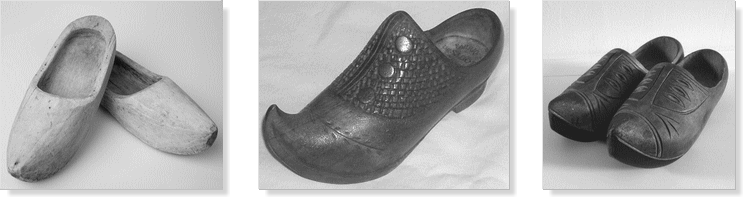
1 François Villon utilisa le mot « sabot » en 1512 dans sa « Ballade de la Grosse Margot ».
2 protecteur contre la chute d'objets, isolant électrique, antidérapant.3 outil à lame recourbée et manche court.
4 grande lame qu'un anneau fixe à un établi à une extrémité, l'autre ayant une poignée.5 couteau pour casser les arêtes.
6 périple d'apprentissage de l'aspirant chez des maîtres de sa profession qui lui transmettent leur savoir et leur expérience.
7 titre décerné uniquement en France par catégorie de métiers dans un concours entre professionnels.8 forêt de hêtres.